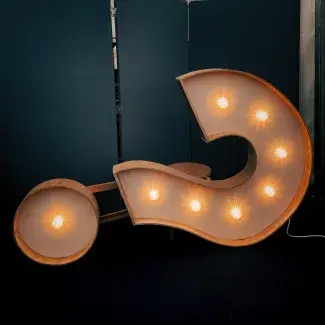
Sécurité(s) rurale(s). Préfets, gendarmes et autres acteurs de la sécurité publique face aux crises (XIX-XXIe siècles)
Sciences Po Grenoble-UGA, 11-12 décembre 2026
Assurément, quelque chose se joue aujourd’hui en termes de sécurité et de ruralité, ou plutôt ne joue plus. Pour qui en doutait encore, le choc suscité par le meurtre du jeune Thomas Perotto à Crépol, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, a mis au jour certaines des tensions dont les campagnes sont devenues le cadre au point de conférer à une rixe de village la portée paradigmatique, prémonitoire ou fantasmée d’un conflit entre deux France. Relayées par les médias, des statistiques indiquent par ailleurs que la délinquance gagne du terrain en milieu rural – surtout s’agissant du narcotrafic, dopé par l’« uberisation » des livraisons, comme l’a signalé la multiplication par dix des saisies de cocaïne en zone gendarmerie entre 2022 et 2024. Les vols font également parler d’eux, puisque des bandes organisées ciblent désormais des matériels agricoles plus sophistiqués et plus faciles à revendre. S’il s’en faut encore de beaucoup pour que s’alignent les chiffres de la délinquance avec ceux des grandes villes, c’est assez pour démystifier la paix des champs. D’autres images fortes – celles de sièges ou d’affrontements en rase campagne – ont signalé, à Sainte-Soline ou à Saïx dans le Tarn, l’ampleur des conflits environnementaux, tandis que les contestations paysannes reprennent de la vigueur. Indicateur inquiétant du champ de contradictions que sont les campagnes désormais, le rôle des agents de l’Office français de la biodiversité, police de l’environnement, fait l’objet de remises en cause qui interrogent la possibilité de faire appliquer les lois en milieu rural.
Bref, voilà de quoi alimenter toute une chronique qui en elle-même aurait le mérite de rompre avec une vision linéaire : celle de la déperdition de la violence rurale, indéniable au milieu du XIXe siècle mais à l’évidence réversible. Ce serait cependant renouer avec la vision spasmodique des campagnes, sortant de l’invisibilisation par des explosions de colère. Pour les sciences sociales, qui y ont pris pied pour mener des enquêtes en profondeur, les enseignements à tirer d’une telle actualité sont d’un autre ordre. Toutes ces affaires sont autant de révélateurs des lignes de fracture qui minent des espaces ruraux fractionnés en raison de leur inégale attractivité socioéconomique et touristique, mais investis par des projets ou par des projections multiples, parfois contradictoires, sinon inconciliables. Autant dire que les historiens pourront nourrir cette interrogation tant le mode d’ordre de développement ou de modernisation des campagnes aux XIX et XXe siècles a suscité sa part de luttes.
Du reste, cette conflictualité est du ressort d’institutions étonnement stables sur la longue durée, partenaires historiques pour la cogestion de l’ordre et de la sécurité : la gendarmerie, dont le service est
« particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grandes routes », selon les termes de la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) et dans le prolongement d’une mission explicitée dès 1720 pour la maréchaussée ; le préfet, dépositaire de l’autorité de l’État, chargé d’appliquer localement la politique définie par le gouvernement, de contrôler les actes des collectivités territoriales, et responsable de l’ordre public et de la sécurité sur tout le territoire du département. L’échelon des sous-préfectures, bien qu’allégé depuis 1926, est alors crucial. L’effacement de la tutelle déconcentrée généraliste sous l’effet de la décentralisation et de la nouvelle gestion publique conduit en partie à un recentrement sur des fonctions prioritaires, non seulement pour répondre à la demande accentuée de sécurité résultant de l’augmentation des atteintes aux personnes et aux biens avivée par l’abaissement du seuil de sensibilité, mais encore pour remplir les nouveaux engagements de l’État en matière de préservation des milieux naturels et de défense de la biodiversité. La mission de protection qui incombe à l’administration préfectorale s’en trouve élargie et la presse à prendre des mesures selon le principe de précaution. Cette extension vaut tout autant pour la gendarmerie qui a fait de la protection de l’environnement, et son corollaire la criminalité et la délinquance environnementales, l’un de ses enjeux prioritaires.
Voilà qui intensifie l’ambiguïté constitutive de la force publique, précisément seule habilitée à user de la force publique – la violence légitime des sociologues – dans le double but de protéger et de réprimer, non sans les tensions qu’illustre à l’évidence la sécurité routière : pour faire reculer la létalité sur les routes, ne s’agit-il pas de verbaliser et de poursuivre les comportements dangereux en une surveillance souvent mal vécue ? En 2020, le déploiement des gendarmes pour fermer, conformément aux arrêtés préfectoraux, l’accès aux voies d’eau, plages, forêts et, plus largement, pour veiller à l’application des mesures de confinement revenant à interdire l’accès à la campagne pour les citadins, a conduit à une expérience inédite de surveillance de masse au nom de la préservation de la santé. Les conflits de priorité s’installent dans les organigrammes. On sait ainsi les passions et les procédures suscitées par la constitution au sein de la gendarmerie de la cellule DÉMÉTER, destinée à lutter contre l’agribashing et les intrusions dans les exploitations agricoles, mais décriée par beaucoup parce que la protection des activités des uns semble passer par la répression de celles des autres (notamment les associations de protection des animaux), et parce que reposant sur des conventions entre le ministère de l’Intérieur, la gendarmerie et les acteurs du monde agricole. Or cette crispation sur DÉMÉTER ne doit pas faire oublier le CESAN (Commandement pour l’environnement et la santé) et ses missions : protection du milieu ambiant et du vivant, préservation du cadre de vie, sécurité de l’homme dans son milieu, police de la transition énergétique. À leur corps défendant, préfets et gendarmes sont en première ligne de choix de société hésitant entre « fin du monde et fin du mois », mais, là encore, leurs missions les ont exposés dans le passé à des interventions clivantes, à l’instar des forêts, entre préservation des ressources et répression des populations locales.
L’acuité comme l’actualité de la sécurité rurale a donné lieu en octobre 2021 au colloque Sécurité-ruralités, qui a travaillé certaines thématiques (Mesurer la délinquance dans nos campagnes, Comprendre et analyser la délinquance en milieu rural, Organiser une politique de sécurité territoriale, La gendarmerie face aux défis de demain dans les territoires ruraux). Pour saisir l’intrication des enjeux à différentes échelles, leur résonance dans l’histoire, tout en prolongeant le suivi des politiques de sécurité, le colloque de Grenoble convoque l’expertise complémentaire de plusieurs centres de recherche et de diffusion des savoirs : la chaire Histoire, Gendarmerie, Sécurité & Territoire(s), le comité scientifique du département d’histoire préfectorale de l’IHEMI et le Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable (CHEDD), le Laboratoire universitaire Histoire Culture Italie Europe (LUHCIE) et le le Centre d’Histoire du 19e siècle, avec le soutien de la Société nationale de l’histoire du patrimoine de la Gendarmerie (SNHPG). Résolument interdisciplinaire, la rencontre est appelée à réunir des géographes, des démographes, des historiens, des juristes, des politistes et des sociologues, et veillera à favoriser les échanges avec les préfets, les gendarmes, les élus ou les milieux associatifs. Seront par ailleurs privilégiés les travaux attachés à cerner la collaboration entre les différents acteurs de la sécurité publique, en prenant pleinement en compte le rôle des maires et des gardes champêtres. Le révélateur des situations de crise bénéficiera d’une attention particulière. Appelées à se croiser, les interventions pourront s’inscrire dans les directions suivantes, pourvu que les modalités de l’ordre public (dans toutes ses dimensions : sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique, moralité publique, respect de la dignité humaine) soient au cœur du propos, et en faisant toute sa place à l’épaisseur historique :
Les mouvements paysans, dans une histoire si longue que le répertoire ferait croire au rituel entre préfets, gendarmes et agriculteurs, par-delà les regains de conflictualité ;
La prévention des risques naturels, le déploiement des secours en cas d’incendies, d’inondations et autres épisodes climatiques extrêmes, qui se nourrit des leçons passées ;
Les violences en milieu rural, telles que les rixes intercommunales d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi la question des violences intra-familiales ;
La criminalité rurale, depuis les méfaits des chauffeurs ou le parcours de Vacher jusqu’à nos jours, avec ses constantes et reconfigurations (les groupes criminels itinérants), et leurs échos dont témoignent l’essor du polar rural noir ou l’emballement rumoral autour des « chevaux mutilés » durant l’été 2020 ;
Les conflits d’usages, de la guerre des Demoiselles aux conflits récents autour de grands chantiers (centre d’enfouissement, Center Parc, tunnels de la nouvelle ligne Lyon-Turin, A69…), ou de façon plus diffuse (conflits entre randonneurs, chasseurs et éleveurs ; rave parties, pression sur les sites de baignade, etc.), lorsque la rationalité de l’État se heurte aux savoirs locaux, aux mouvements militants, parfois engagés dans des stratégies de légitimation de la violence, ou aux contre-expertises civiles, lorsque les modes de vie des uns heurtent les moyens d’existence des autres.
La sécurité routière, avec ses pics (les années 1970) et reflux, en lien avec l’évolution des comportements, de la prévention et de la répression, en particulier en campagne ;
Les mobilisations environnementales, à saisir là encore dans leur épaisseur historique ;
Pour soumettre votre proposition de communication, merci d’envoyer à l’adresse securiterurale@gmail.fr un résumé d’une page, accompagné d’un titre provisoire et d’une courte bibliographie au plus tard 31 octobre 2025. Les contributions seront examinées par le comité scientifique et une réponse sera apportée courant novembre 2025.
Le colloque se tiendra à Sciences Po Grenoble-UGA les 11 et 12 décembre 2026. Il est organisé avec le soutien de la Chaire Histoire, Gendarmerie, sécurité et Territoires(s) https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/chaires-de-recherche/la-chaire-higeset/presentation- d-higeset, du département d’histoire préfectorale de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur https://www.ihemi.fr/recherche-et-prospective/departement-dhistoire-prefectorale-et- du-ministere-de-linterieur, du Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/le-comite-d-histoire-a3503.html
, du Laboratoire universitaire Histoire Cultures Italie Europe et du Centre d’Histoire du 19e siècle. Une publication des actes est prévue.
Responsables scientifiques : Arnaud-Dominique Houte et Aurélien Lignereux
Comité scientifique
Perrine Agnoux
Jean-Michel Bricault
Benoît Haberbusch
Camille Chaussinand
Fabien Conord
Pierre Karila-Cohen
Jean-Noël Luc
Corine Marache
Nancy Meschinet de Richemond
Benoît Vaillot
Général Jean-Régis Véchambre
Nadine Vivier