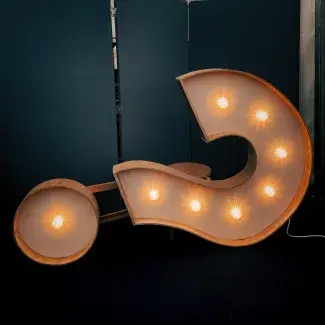
VIIe rencontres du XIXe siècle "Violences" 4-5 juin 2026 - Paris
Depuis 2019, en partenariat avec la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, les Rencontres du XIXe siècle réunissent des jeunes chercheuses et chercheurs, issu.e.s de différentes universités et appartenant à divers champs historiographiques, pour discuter d’une notion spécifique. Après "Petites et Grandes Rencontres" (Paris, 2019), "Populaire" (Toulouse, 2021), "Nature" (Dijon, 2022), "Progrès" (Lille, 2023), "Révolution[S]" (Le Mans, 2024) et "Empires" (Clermont-Ferrand, 2025), les septièmes Rencontres du XIXe siècle font leur parenthèse parisienne et sont consacrées aux "Violences". Elles sont accueillies par le Centre d’histoire du XIXe siècle. La leçon inaugurale sera donnée par Anne-Emmanuelle Demartini.
Argumentaire :
Violences plurielles. Le XIXe siècle, s’il est à juste titre considéré comme celui du progrès, de l’espérance et de l’opportunité (Fureix, 2014), est aussi, paradoxalement, une période marquée quotidiennement par les violences, de nature, d’ampleur et d’intensité variables[1] . Elles se caractérisent par la dégradation, voire la destruction, physique, psychique ou symbolique d’un individu ou d’un groupe donné. En outre, leurs définitions en elles-mêmes soulèvent de nombreux enjeux. Entre les guerres, les révolutions et tout ce qui fit cette « modernité désenchantée » (Fureix et Jarrige, 2020), ces violences, des plus collectives (guerres, révolutions) aux plus intimes (conjugales, intra-familiales), des plus systémiques (politiques, colonisation et/ou esclavage, industrialisation) aux plus individuelles (interpersonnelles), des plus manifestes (conquêtes, fait divers) aux plus invisibles (violences environnementales, violences implicites), des plus extrêmes (massacres, répressions sanglantes) aux plus ordinaires (monde du travail, hiérarchies raciales, sociales et de genre) ; sont à la fois une « idée » obsédante pour les contemporains comme pour l’historien.ne, un prisme d’analyse utile pour penser les évolutions sociales et les interactions entre les individus et un objet d’étude à part entière. C’est avec cette pluralité des approches que les VIIe rencontres se proposent de les étudier.
Concevoir les violences. Les violences sont, avant toute chose, des pratiques concrètes, qui se conçoivent selon des modalités différentes en fonction des acteurs qui les infligent ou les subissent, et des cadres et espaces dans lesquels elles s’exercent. Si certains lieux ou moments semblent évidemment propices à la mise en actes de violences, tels les guerres, les temps révolutionnaires ou les conquêtes coloniales, d’autres laissent s’exprimer des violences ordinaires (Poutrin et Lusset, 2022), plus discrètes mais non moins structurantes. On pensera par exemple aux manufactures et ateliers[2] [3] [4] (Cohen, 2013), qui voient se mettre en place des modes de dominations physiques et psychologiques ou à la sphère domestique, jusqu’au huis-clos de la chambre à coucher (Limbada, 2023), marquées par les violences intergénérationnelles (Ambroise-Rendu, 2014) et de genre (Vanneau, 2023). Les violences s’insèrent toujours dans des dynamiques d’autorité plus ou moins affirmées (autorité d’un acteur, d’un rythme, d’une structure, etc.) qui, parce qu’ils sont en position dominante, sont en capacité d’exercer la contrainte, l’intrusion, la violation ou la privation. Ces dynamiques d’autorités, intéressantes à étudier pour elles-mêmes, se trouvent ainsi révélées par les violences qu’elles permettent et qui les illustrent autant qu’elles les façonnent (Génard et Rossigneux-Méheust, 2023). En conséquence, elles nous semblent être une porte d’entrée intéressante pour aborder la question des pratiques de violence. Le comité sera attentif aux propositions travaillant sur les structures d’isolement, d’enfermement ou d’exclusion (Perrot, 2003) : par exemple, il serait intéressant d’interroger les violences qui ont cours dans le monde médical, notamment à l’égard des femmes – y compris dans une perspective intersectionnelle.
Les violences en question. Le XIXe siècle se distingue par un renouvellement de la réflexion sur les violences, en particulier au sujet de leur légitimité et de leur acceptabilité. Entre autres, on pourrait se demander si ces réflexions et leur portée concrète se reflètent sur le plan normatif (Riot-Sarcey, 2023). Par exemple, à la fin du siècle, lorsque se construisent le syndicalisme et les consciences de classe, c’est l’articulation de rapports de domination et des violences qui en résultent qui sont mis en exergue et condamnés par les penseurs du monde du travail. Ces réflexions traduisent une évolution des seuils de tolérance face aux violences. En effet, si elles sont pensées, elles sont aussi dénoncées, critiquées et font l’objet de réflexions législatives toujours plus importantes, en témoigne l’attention croissante des autorités politiques portée au maintien de l’ordre et à la sûreté (Houte, 2010), face à l’écart à la « norme » matérialisé par les émeutes et révoltes (Deluermoz, 2012). On pensera aussi aux violences de guerre et à la prise en compte progressive du sort des blessés. Le XIXe siècle voit ainsi s’affirmer une condition de victimes, révélatrice d’un renouvellement du rapport aux violences. Il s’agira ainsi d’interroger les modalités de cette remise en question, d’en comprendre les ressorts (sociaux, politiques, culturels, médiatiques) et d’en évaluer les effets concrets sur les pratiques politiques (Caron, 2008), sur l’encadrement juridique, sur les formes de guerre, mais aussi sur les sensibilités collectives.
Violences et imaginaire social. L’expression des violences passe aussi par une production massive de discours (violents et sur la violence) dans le monde politique, la presse et l’expression populaire, y compris à échelle individuelle (Demartini et al., 2024). Le renouvellement historiographique sur la criminalité (Demartini, 2001, 2017 ; Kalifa, 1995 ; Ambroise-Rendu, 2006), a notamment porté son attention sur la construction du fait divers, ses effets et son langage. En France comme à l’étranger, ces mises en discours, faites tantôt pour légitimer, tantôt pour condamner les violences sont porteuses de significations et contribuent à façonner un imaginaire social que l’on peut approcher selon les prismes de l’histoire des représentations et sensibilités ou de l’histoire culturelle. En la matière, il faut noter que le XIXe siècle est celui d’une remise en question des canons artistiques autant en littérature qu’en art (Fraser, 1976 ; Graybill, 2016), allant jusqu’à créer une nouvelle esthétique de la violence voire de l’abject. En outre, les violences s’inscrivent dans un imaginaire du permis et du non permis, du légitime et de l’illégitime, de la norme et de la transgression, en même temps qu’elles participent à le produire (Corbin, 1999). Il sera utile de travailler sur cet imaginaire, de tenter d’en retracer les contours et les évolutions au fil du siècle. L’approche micro-historique pourrait ici être privilégiée, tant elle a montré son efficacité pour reconstituer les systèmes de représentation[5] .
Violences informelles. Certaines violences échappent aux manifestations spectaculaires : elles relèvent de l’ordre du symbolique, du quotidien ou de la domination silencieuse (Bourdieu, 1979). Ces violences « normales » ou intériorisées (Mazurel, 2021, 2023), tant elles sont structurelles et structurantes, peuvent échapper au regard de l’historien.ne. C’est pourquoi il serait intéressant de les repérer et d’en mettre en relief les composantes. Notamment, l’historiographie récente a montré combien les violences raciales (Wacquant et Crox, 2024), sexistes et de classe traversent aussi bien les relations sociales ordinaires que les institutions et structures collectives. Dans le même ordre d’idée, les violences symboliques ou invisibles disent beaucoup des imaginaires sociaux et de leur traduction en pratiques, à toutes les échelles d’analyse. En termes de violences symboliques ou invisibles, on pensera aussi aux dominations silencieuses de la modernité et à leurs évolutions : l’interaction entre l’humain et son moyen productif ou de circulation et même avec son environnement sonore peuvent être porteurs de violences (Corbin, 1994), et inversement générer de nouvelles formes d’opposition (réaction à la modernité, conscience environnementale en gestation, etc.). Enfin, l’attention croissante portée aux violences au-delà de l’humain (Stépanoff, 2024), qu’il s’agisse de l’exploitation animale ou des violences environnementales (Jarrige et Le Roux, 2017 ; Fressoz et al., 2025), invite à élargir l’analyse pour comprendre avec plus d’acuité les dynamiques de domination et leurs significations potentielles.
Le sens des violences. L’étude des violences ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur leur sens. En effet, les violences sont aussi un langage (Audoin-Rouzeau, 2020), porteur de significations pour les contemporains comme pour l’historien.ne. Les analyser, c’est donc aussi chercher à décrypter ce qu’elles expriment des rapports sociaux, politiques, culturels, voire anthropologiques (Fassin, 2025). Par exemple, on ne comprendra pas la violence du monde militaire sans penser leurs spécificités, que sont la disciplinarisation, la légitimation et la brutalisation. Cette conscience des singularités des violences ne doit pas occulter les circulations de pratiques, que l’on pourra étudier (du champ militaire à celui du maintien de l’ordre, du monde du travail à celui de la rue, de l’abattoir à la criminalité, du groupe violent au groupe violenté). Les pratiques de violences s’inscrivent dans des continuum entre représentations et pratiques, faites d’imbrications, de superpositions et de transferts. Tenter de comprendre ce langage, c’est ainsi mettre en lumière le rôle structurant des violences dans l’histoire du XIXe siècle.
Nous rappelons que ces Rencontres sont destinées en priorité aux jeunes chercheuses et chercheurs, des doctorant.e.s de première année aux post-doctorant.e.s. L’ambition de cette manifestation est de favoriser la rencontre et le dialogue entre doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s. La diversité des thèmes envisagés doit permettre un large panel de communications. Les propositions peuvent donc porter sur tout type de contexte et d’approche, de la micro-histoire à l’histoire globale et sont invitées à explorer un ou plusieurs des axes évoqués dans cet appel.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication (en français ou en anglais, de 2 000 signes maximum) devront être envoyées à l’adresse rencontres19eme@gmail.com avant le 2 mars 2026, accompagnées d’un court CV.
Le colloque se tiendra du 4 au 5 juin 2026 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le logement (dans la mesure du possible) et deux repas seront pris en charge par l'organisation, mais les frais de déplacement seront à la charge des participant.e.s et/ou de leur laboratoire de rattachement.
Comité scientifique et d’organisation :
- Théo Behra (Université de Strasbourg)
- Chloé Chatrian (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Marie Clemenceau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Étienne Hudon (Université Paris Cité / UQÀM)
- Adélaïde Marine-Gougeon (Sorbonne Université)
- Pierre-Louis Poyau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- François Robinet (Université Clermont Auvergne / Université Savoie Mont Blanc)
- Francesco Scatigna (University College Dublin)